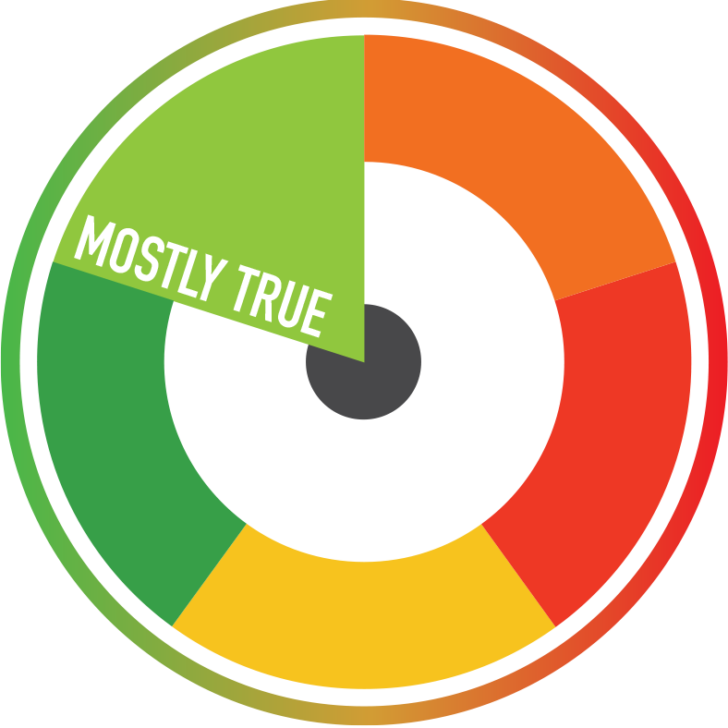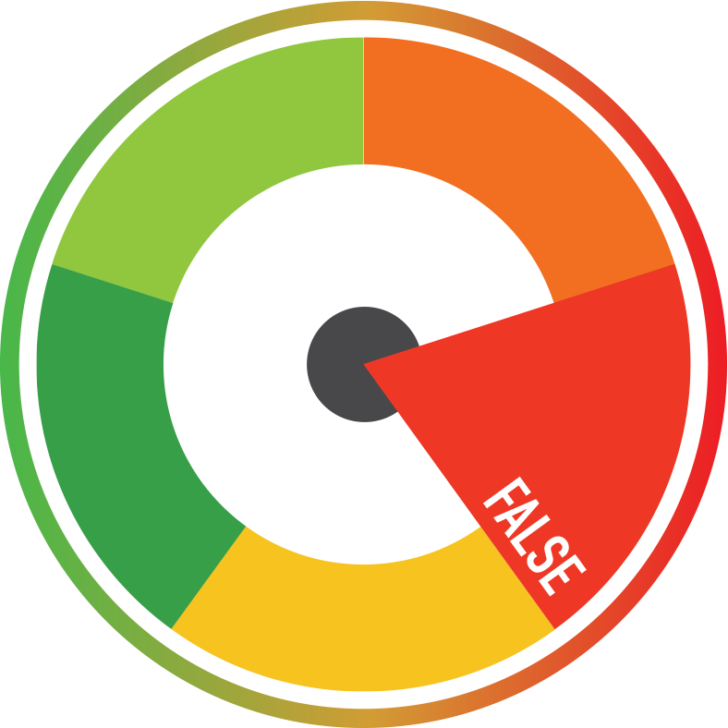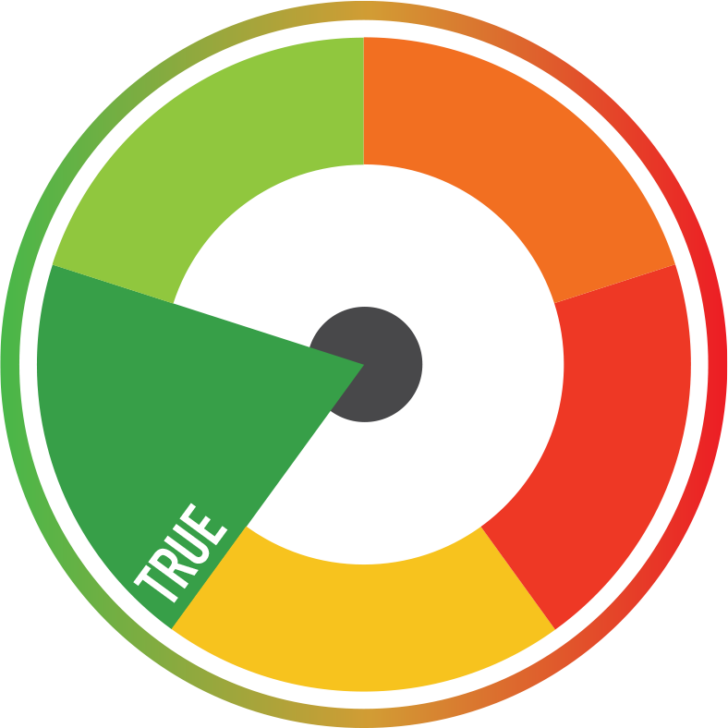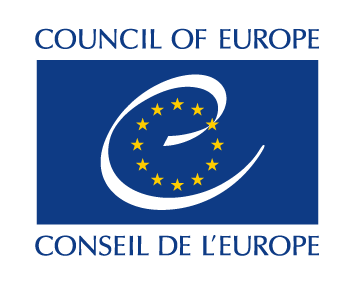The EUFACTCHECK project
EUFACTCHECK is the fact-checking project of the European Journalism Training Association (EJTA) that intends to build a sustainable curriculum unit on fact-checking within a European network of Journalism schools.
Through fact-checking European political claims and trying to tackle misinformation, we want our students and our public to grow a deeper insight and interest in democratic processes, both on national and European level.
EUFACTCHECK wishes to motivate fact-based debate in the EU and to stimulate media and information literacy.
Our history
After the success of the students’ publications, the participants of EJTA’s fact-checking project EUFACTCHECK decided at the EJTA AGM in Paris (July 2019) to move on with the project and to take new steps in the academic year 2019-2020.
By January-February 2019 a manual with guidelines and tips & tricks was published. In February 2020 a second Bootcamp will be organised in Ljubljana, with financial help from the Evens Foundation. This Train the Trainer focused on Central Eastern European countries, some new schools joined this project.
During corona the EJTA-schools continued to verify claims and publish fact checks. Now we are looking ahead to the 2024 EU elections.
For information about the EUfactcheck project please contact the programme manager: carien.touwen@hu.nl